la orilla umbria del Ebro
Très heureux d’être représenté en Espagne par Sophie Savary, agent double.
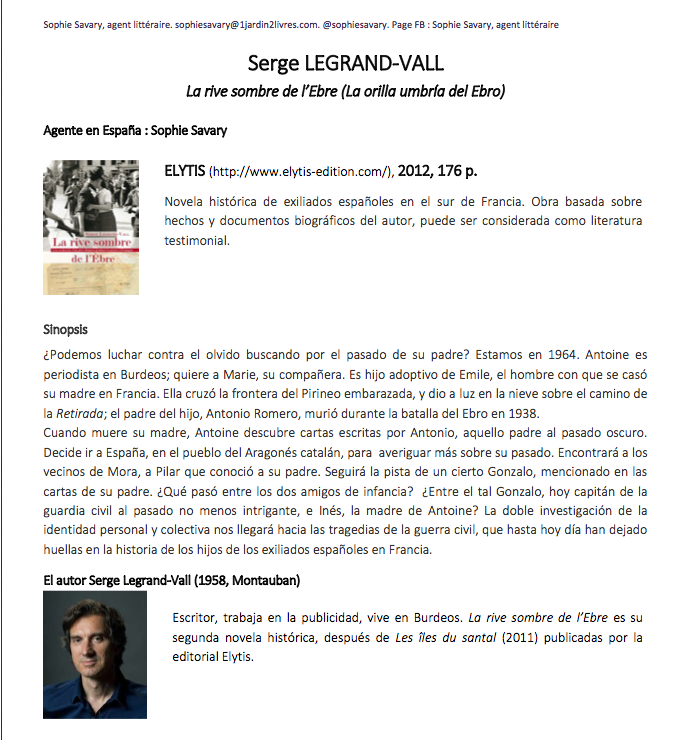
Très heureux d’être représenté en Espagne par Sophie Savary, agent double.
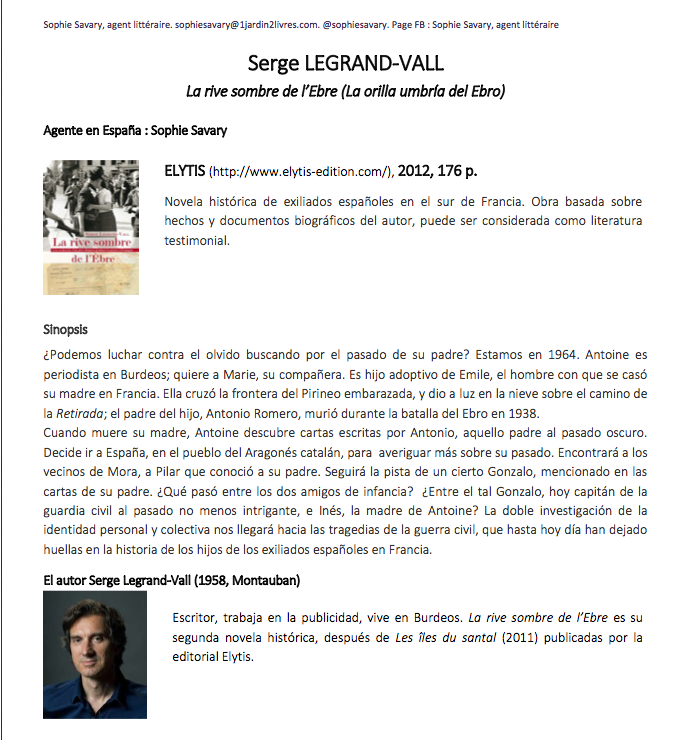

Avril 1938. L’offensive des troupes franquistes sur le haut-Aragon fait fuir des milliers d’Espagnols vers la France par les cols pyrénéens. Au cours de cette première “retirada”, une femme épuisée accouche en pleine montagne, dans la neige. L’enfant sera Français. Son père, resté sur le front, ne reviendra pas de la bataille de l’Èbre. À partir de cette histoire authentique, l’auteur retrace l’itinéraire d’une femme et de ses parents réfugiés qui ont décidé, pour rebâtir leur vie en France, de ne plus jamais parler des déchirements de la guerre. Le poids de ce silence suscitera chez Antoine, le fils devenu adulte, une vocation de journaliste. La mort prématurée de sa mère lui offre la possibilité de rompre le pacte d’oubli familial. Vingt-six ans plus tard, guidé par des lettres retrouvées de son père, il part en Espagne pour comprendre ce que personne n’a pu lui raconter.
Serge Legrand-Vall vous présente son ouvrage « La rive sombre de l’Ebre » aux éditions Elytis. Rentrée littéraire janvier 2013.

Écrire, c’est toujours voyager dans un monde intérieur sans lumière. Il y a très longtemps que j’avais envie d’entreprendre ce périple dans le pays disparu de ma famille, dans des événements refoulés. J’ai su très tard, beaucoup trop tard. J’ai beaucoup interrogé, mais obtenu peu de réponses. La mémoire familiale est comme un champ de ruines dans lequel on retrouve ça et là un objet qui rappelle la vie des anciens habitants. Il faut de grands efforts d’imagination pour reconstituer ce qu’a pu être ce passé enfoui. J’ai pu sauver quelques bribes, informations, photos. Bien peu. Et pourtant cela suffit.
Cela suffit parce que je suis constitué de ce silence et de cet insu. Parce que bâtir des constructions imaginaires sur les fondations ruinées est une des choses que je sais le mieux faire. Peut-être aussi cela m’arrange t-il de ne pas savoir pour me servir de la liberté, de la légèreté de l’écriture. Non je ne sais pas ce qui s’est passé et pourtant, je sais. Je sais ce qui manque et c’est cela que je vais raconter. Quand la guerre est civile, les repères disparaissent, les pères aussi. Dans ce livre, la bataille de l’Èbre est le tombeau d’un père tombé au front en 1938. Un père énigmatique que la mère confond dans son discours avec son mari français, et dont le fils ne connaît que le portrait. C’est l’histoire d’un secret et de la douleur qui l’entoure, dans une période d’idéaux et d’engagement.
Le 1er avril 2013, à l’occasion de l’Escale du Livre de Bordeaux.
EXTRAIT
“Lundi 23 mars 1964
Les passagers agitaient les bras depuis les ponts du grand navire blanc. Le froid piquant de ce petit matin de mars laissait monter de la foule sombre restée à quai les échappées de vapeur des cris. Arrivé en courant avec Maurice, Antoine commençait à frissonner en ressentant la sueur glacée de sa course. La marée était haute, faisant paraître plus imposant encore le navire dont la proue avait déjà quitté le quai. Le soleil tardait à se lever dans un ciel pâle et laiteux. En amont sur la même rive, les noirs squelettes des grues étaient encore immobiles à cette heure matinale. Il aurait été dommage de manquer le départ de l’un des derniers paquebots des lignes régulières de Bordeaux. La concurrence de l’avion et du train était devenue trop forte. Le temps de la navigation paraissait révolu et c’était là le sujet de l’article qu’Antoine devait écrire pour la parution du lendemain. Un article plutôt ambitieux pour un débutant, mais le rédacteur en chef lui faisait confiance. Tu m’as l’air doué pour ce boulot, lui avait-il dit la veille en le mettant sur ce coup. C’aurait été encore mieux si j’avais réussi à me lever à l’heure, pensa Antoine en sortant de sa poche son calepin à spirales. C’est alors qu’un cri rauque, plus puissant et plus proche que les autres, déchira l’air humide, suivi du son de la sirène du bateau qui emplit tout l’espace. Antoine et Maurice se précipitèrent à l’endroit où un attroupement se formait et d’où fusaient des exclamations. Ils arrivèrent au ras du quai, juste à temps pour voir un homme tombé à l’eau attraper la bouée qu’un de ses collègues venait de lui lancer.
– Eh ben, tu vas avoir de quoi le corser, ton papier ! Maurice s’était accroupi pour approcher au plus près et faire les meilleures photos. Déjà, l’homme ruisselant, cramponné à la corde attachée à la bouée, se laissait hisser en prenant appui sur la pierre glissante.
– Qu’est-ce qui s’est passé ? Demanda Antoine à un docker à bonnet qui interpellait l’ouvrier malchanceux : “Alors, tu ne t’étais pas lavé, ce matin ? ”
– Cette andouille n’a pas lâché l’amarre assez vite, il s’est laissé entraîner ! Et puis regardez ces pavés, dès qu’il fait humide, on y glisse comme sur des peaux de bananes ! L’ouvrier du port, revenu du choc de son immersion et entouré de compagnons qui le frictionnaient, accepta de poser pour le photographe avant d’être emmené dans le hangar de la gare maritime pour y être séché et réchauffé. Antoine eut un nouveau frisson en pensant à la température de l’eau de la Garonne. Il n’avait jamais beaucoup aimé l’eau et ce n’est pas ce matin que ça allait changer. Indifférent à l’incident, le paquebot Foucault 2 s’éloignait vers l’aval, crachant une fumée noire de son unique cheminée. Le nombre de passagers curieux avait augmenté sur le pont arrière. Dans quelques jours, le paquebot atteindrait les côtes africaines, sa destination. Sans racine bordelaise, ignorant de l’histoire du port et de sa navigation, Antoine devait la seule histoire qu’il connaissait à Ramón, son copain de Toulouse. Une histoire de républicains espagnols, évidemment. Il s’agissait de l’épopée du Winnipeg, un cargo qui avait convoyé en 1939 deux mille cinq cent réfugiés, de Bordeaux à Valparaiso. Une odyssée comme aimait à les raconter son ami. Il avait retenu en particulier de ce récit une anecdote, celle de ces couples, formés pendant ce voyage qui les emmenait loin des épreuves et des souffrances, qui faisaient l’amour dans les canots de sauvetage. C’était une belle image, pour des rescapés. – Bon, je vais faire développer, à plus tard ! Pressé, Maurice repartit vers sa mobylette posée contre une grille. Antoine avait encore quelques questions à poser à la capitainerie concernant le navire. Il se mit à rêver de voyage, lui qui n’avait jamais mis un pied hors des frontières.”
Voici une analyse singulière qui me plaît beaucoup, signée Betty Pujades :
Il y a une composante dans ce roman dont j’aimerais parler. Elle était déjà présente dans « les îles du Santal » mais j’y ai été plus sensible ici, peut-être parce que je les connaissais, étant d’origine catalane. Ce sont les odeurs. En fait, il me semble qu’elles sont au cœur même de l’essence de ce roman, qui, grâce à elles, « sent bon l’Espagne ». On pourrait presque leur accorder la place d’un personnage qui intervient de façon significative pour enrichir le roman à plusieurs niveaux. J’en ai détaillé 4 :
1 – Les odeurs viennent compléter la vision du quotidien.
2 – Elles sont en interaction avec les personnages
3 – L’odeur = vedette de l’action.
4 – Les odeurs s’inscrivent dans l’essence du roman dont elles soulignent la spécificité.
1/ Les odeurs viennent compléter la vision du quotidien P35 : les fromages aux odeurs fleuries P40 : l’odeur de linge propre, de fleurs séchées et de vieux bois. P78 : odeurs de résine et de poussière. P98 : l’odeur d’aubergine et de tomate confite, lard et oignon P135 : l’air était rempli des odeurs fraîches de la rivière et des murmures du courant.
2/ Elles sont en interaction avec les personnages P81 : « une assiette de pain, tomates, olives et serrano, arrosée d’un vin parfumé du Priorat qui l’avait mis de bonne humeur. » (à Lérida) P115 : « il avait respiré ses cheveux, un parfum doux de fleurs séchées, d’immortelles. Il en avait ressenti un plaisir aigu. » (Nuria) P137 : en parlant du père de Nuria : « Antoine sentit son odeur âcre de transpiration et de tabac ». (Connotation négative qui sent le rejet et le dégoût.)
3/ L’odeur a la vedette de l’action. P85 : (au début de la 2ème partie) l’odeur de fumée réveille Antoine, quand la maison du vieil Appolo brûle. « Une agitation confuse et une odeur de fumée. Non, de brûlé. A cette pensée, il s’éveilla d’un coup. L’odeur était bien là, réelle. »
4/ Les odeurs s’inscrivent dans l’essence du roman dont elles soulignent la spécificité. P81 : On est en Espagne, et les odeurs apportent à Antoine la conscience d’être en terre étrangère. « La fraîcheur était tombée, mais elle n’avait rien à voir avec le froid vif des soirées pyrénéennes. Par la fenêtre de la portière ouverte, Antoine respirait des odeurs étrangères, mates, grasses. Des odeurs lourdes de secrets envasés, entraînés par les flots lents. Des odeurs minérales aussi, venues de ces roches grises qui portaient un manteau d’arbres maigres et tortueux. » (« secrets envasés », les flots lents » = qui ont emporté le père d’Antoine et emporteront celui de Nuria.) (« roches grises » « arbres maigres et tortueux » = cette partie de l’Espagne.)
Ces odeurs que l’auteur sait si bien décliner à l’infini, ne seraient-elles pas une des marques de son ADN littéraire ?
Betty Pujades
Présentation des deux ouvrages par Fabrice Corrons, maître de conférences Catalan-Espagnol à l’Université de Toulouse-le-Mirail, laboratoire LLA-CREATIS.

Voici deux ouvrages publiés chez Elytis autour d’histoires de la République Espagnole : – Enfants de la mémoire. 32 victimes de la guerre d’Espagne racontent, traduction d’un ouvrage espagnol « Traumas de los niños de la guerra y del exilio » étdité le 15 octobre 2010 par l’association pour la Mémoire et l’Histoire du Baix de Llobregat (AMHDBLL) dont le Président est Francisco Ruiz Acevedo. Laure Lataste est la traductrice et la coordonnatrice de cette œuvre collective qui s’est donnée pour priorité de promouvoir ce livre en donnant la parole à ces témoins qui ont vécu et souffert de ces horreurs dues aux fascistes espagnols et européens.. – La rive sombre de l’Ebre. A la recherche d’un père disparu pendant la guerre d’Espagne de Serge Legrand-Vall. Un roman d’apprentissage particulier, car l’initiation a une dimension transfrontalière et se fait hors des sentiers battus, à travers une quête qui, comme l’indique le sous-titre, amène un jeune Français à franchir les Pyrénées pour comprendre la mort de son père, soldat républicain, du côté de Mora d’Ebre. Deux ouvrages qui se répondent, comme s’ils étaient médiatisés par le miroir de nos vies :
-d’un côté, un témoignage conséquent (330 pages), et polyphonique (32 récits de vie) autour de ce qu’a représenté l’exil pour des enfants, ceux que l’Histoire terrible de la Guerre d’Espagne 36/39 a nécessairement traumatisés avec une acuité particulière… car, comme il est précisé en introduction, la construction de l’enfant, à ses différents âges, de la réalité est bien distincte de celle des adultes. Et nous voyons alors se dessiner un début de panorama, forcément incomplet, de ces sans voix, car chaque récit de guerre est unique par le lieu du traumatisme, le contexte familial, le lieu de l’exil : Gurs, Le Vernet, Elne, Argelès, la Normandie, Limoges, Paris, Bordeaux, etc., en France ; l’Angleterre, le Mexique, Buenos Aires, Oran…
-et d’un autre côté, le travail de création romanesque, d’imagination qui met en lumière, par le biais de la fiction, un autre témoignage. Un témoignage qui a une valeur équivalente à celle de ces 32 enfants, d’autant plus que ce témoin fictif, Antoine, partage avec celui de Laure Garralaga Lataste des caractéristiques biographiques similaires: ils ont tous les deux vécu le passage de la frontière dans le ventre de leur mère. Dans le cas de la fiction romanesque, cette expérience utérine de l’exil est d’autant plus forte que l’accouchement a lieu juste après avoir passé la frontière espagnole, dans les terres françaises. Mais cette dramatisation que l’auteur utilise, avec parcimonie et sens du rythme romanesque et du suspense, n’est pas le propre de la fiction.
Les témoignages que nous livrent ces 32 enfants de la guerre d’Espagne 36/39 sont tout autant dramatiques, comme le montrent de nombreux récits où le témoin prend le temps d’expliquer sa vie paisible d’avant pour rendre compte avec davantage de force du choc de la guerre qui a dévié le cours normal des choses et de l’évolution psychologique de l’enfant. Les passages où la guerre et l’exil, forcé, sont décrits avec les yeux des enfants, pourraient être dignes des plus beaux romans et films, mais c’est la tragique vérité. Et c’est cet ancrage inébranlable dans une réalité, une Histoire récente des Espagnols dont nous connaissons tous les faits, qui donne à ces récits de vie, à ces témoignages nécessairement reconstruits par la mémoire une amertume et une gravité singulières. Ces scènes cruelles, ces images-sons d’horreur, de détresse, quoique vues par le filtre de l’adulte qui se remémore son enfance, quoique intégrées dans un récit vital qui fait souvent la part belle à l’avenir plus radieux qu’ont connu ces enfants, quoique mises en contexte et encadrées par une préface et une postface scientifiques de spécialistes de la question des traumatismes, frappent le lecteur.
Il est dur, même si nécessaire, de lire ces récits. Et c’est peut-être dans cette difficulté de lecture du témoignage vrai que réside une des grandes forces du roman de Serge Legrand-Vall. Parce qu’il nous offre une vision inverse : non pas de celui qui porte, depuis son enfance, le poids d’un passé traumatisant transmis par ses parents et/ou vécu directement. Mais celui qui découvre à la mort de sa mère une trace de son passé, de son père plus exactement, celui qu’est venu par la suite substituer, en quelque sorte, Emile, français détaché de cette guerre d’Espagne. Et qui part à la recherche de cette partie de son identité jusqu’alors mystérieuse, traversant les Pyrénées pour rejoindre Mora d’Ebre, ce petit village du sud de la Catalogne. Là, tout a commencé pour ses parents, son père y est mort pendant la Guerre, et c’est là que tout recommencera pour le protagoniste et pour Núria, cette fille avec qui il partage son passé « catalan » et avec qui il semble qu’il va reconstruire une nouvelle vie en France, fuyant la police franquiste comme sa mère et ses grands-parents avaient fui l’armée rebelle. Le roman se termine par ce nouveau passage symbolique de la frontière espagnole, au milieu des Pyrénées, franchissement qui rappelle celui de la mère quelques 25 ans plus tôt en 1939, et qui permet de boucler la boucle de cette quête identitaire et de recommencer un nouveau cycle de vie, le regard posé à présent vers un futur qu’ils construiront à deux. La postface de l’ouvrage, en dénonçant l’oubli, imposé ou auto-imposé, de cette période et de ces Espagnols non seulement lie cet ouvrage à ces 32 récits de vie que propose l’autre publication, mais également souligne l’intérêt de la valeur testimoniale de la littérature qui permet de donner une nouvelle « vie », quoique fictive, à ce passé. Fiction et réalité sont impérieuses, dialectiquement nécessaires, dans la construction de toute personne, de tout citoyen. C’est pourquoi il me semble indispensable de lire et le premier et le second ouvrages. Mieux encore : il me semble judicieux de lire les deux ouvrages en même temps ; de commencer par l’introduction scientifique de l’ouvrage documentaire puis de continuer par le premier chapitre du roman et enfin de lire le premier des 32 témoignages…. et puis de recommencer l’alternance entre ces deux ouvrages. L’un et l’autre se nourrissent mutuellement, s’entremêlent dans un rapport entre fiction et réalité judicieusement régi par le pouvoir de narration de l’esprit humain… car, au bout du compte, tout est question de mémoire. Au poids écrasant de l’horreur paralysante se superpose alors la force téléologique du récit vital, dans un mouvement de va-et-vient permanent et positif. Et je trouve que cette double publication est d’autant plus réussie qu’elle donne à entendre la voix de cette part de la société française : cette part issue de l’immigration espagnole, de ce traumatisme de la guerre d’Espagne 36/39… une voix qui pendant très longtemps est restée limitée à la communauté espagnole – et c’était par le passé nécessaire de recréer du lien dans ce pays étranger et par rapport à cette guerre qui avait mis dos à dos deux parties théoriquement indissociables d’un même peuple.
Mais aujourd’hui, cette communauté espagnole prend pour ceux de ma génération et ceux peut-être de la génération directement antérieure, une autre dimension : elle n’est plus une finalité en soi mais partage avec des héritages communautaires d’autres horizons cette question de l’identité. Qui sommes-nous ? Comment et pourquoi nous identifions-nous simultanément à la société française dont nous sommes les produits actuels, à notre passé communautaire étranger, et à nos pairs, eux-mêmes pour la plupart fils d’autres territoires ? Il y a dans ce roman et dans ces témoignages cette question de l’identité, de notre territoire, de notre cartographie intime et familiale qui resurgit et qui peut parler à l’ensemble de la société française, au-delà du public précis qui peut être intéressé par ces deux ouvrages. Cette nécessité actuelle d’une mémoire transfrontalière et de la problématique identitaire trouve ici une intéressante matière à réflexion, plurielle par le caractère polyphonique de l’ouvrage documentaire mais aussi par le kaléidoscope des voix qui viennent petit à petit reconstruire le passé. Autant de versions de la réalité que la réalité elle-même. C’est ce que s’est efforcée de montrer la littérature de la mémoire en Espagne depuis le début des années 2000 et c’est ce que propose cette double publication depuis la France, comme si la littérature de la mémoire pouvait traverser les frontières et de surcroît faire à présent le chemin inverse, de la France vers l’Espagne. Voilà, en quelques mots, ce que proposent ces deux ouvrages à mon humble avis.

Citation de Jorge Semprùn. “Le mort qu’il faut”
La vérité est cette chose insaisissable dont chacun ne voit qu’une partie, avant qu’elle ne soit déformée par d’autres et disparaisse. Certaines vérités se perdent dans l »oubli, irrémédiablement. Or l’oubli est mon ennemi personnel. Je le combats avec mes armes. L’écriture est la principale. Je ne saurai jamais tout à fait comment ceux qui m’ont précédé ont traversé la tourmente de la guerre d’Espagne. Ni ce qu’ils pensaient, ni quelles furent les raisons de leurs choix. Alors, il ne me reste qu’à l’inventer. Cette histoire ne sera donc pas la leur. Les personnages du roman ne seront pas eux. Tout sera différent, car à la différence du récit, le roman n’est pas témoignage. Cependant, aux couleurs que j’ai découvertes, habitée par les passions que j’ai perçues, par les silences qui m’ont bercés, cette histoire sera vraie. Jorge Semprùn, un de mes référents en littérature, avait fait sienne cette citation de Boris Vian dans L’écume des jours : « Dans ce livre tout est vrai, puisque j’ai tout inventé ».
Huit heures de route depuis les Pyrénées pour aller repérer ce village, marcher dans ses rues, découvrir le fleuve lent et les montagnes qui l’environnent, faire des rencontres, trouver les éléments qui me manquent sur son histoire, me poser là brièvement… De la mémoire évanouie de ma famille espagnole, ne reste que le nom de cet endroit, dont est originaire ma grand-mère. Mòra d’Ebre, Mòra la Nova, deux villages qui se font face, de part et d’autre du fleuve. Entourés de vignes, de vergers, d’oliveraies. Théâtre de la bataille de l’Èbre, affrontement d’une extrême violence, qui a précipité la défaite du camp républicain et la fin de la guerre dEspagne. Après avoir rédigé la première partie de ce roman, je devais absolument voir les lieux où se passe la suite, qui est aussi l’avant, là où se noue la tragédie. Plonger dans les eaux sombres de l’Èbre, pendant l’été 1937.

Serge Legrand-Vall en dix dates
1958. Naissance à Montauban.
1964. De l’Ariège à la Normandie, changement de décor et de patronyme.
1976. École Supérieure des Arts appliqués Duperré / Paris.
Auditeur libre en Ethnologie, civilisations amérindiennes / Paris VII Jussieu.
1986. Ateliers Cinématographiques Sirventès, écriture scénaristique / Toulouse.
1995. Bordeaux.
2005. Toulouse Bordeaux l’un dans l’autre (essai), première publication.
2011. Les îles du santal, premier roman suivi d'une résidence d'écriture aux îles Marquises pour La part du requin.
2013. La rive sombre de l’Ebre.
2018. Résidence d'écriture à Barcelone pour Reconquista, avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine.
2022. Un oubli sans nom.
Plus :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serge_Legrand-Vall
Les avis de lecteurs :
https://www.babelio.com/auteur/Serge-Legrand-Vall/111133
L'actu :
https://www.facebook.com/serge.legrandvall
Les livres en stock dans les librairies indépendantes :
https://www.placedeslibraires.fr/
Et les indispensables :
https://www.editionsin8.com/
https://www.editionselytis.com/
D'abord pourquoi vendredi écriture ?
Pour écrire, pendant une vingtaine d'années, j'ai défendu comme une citadelle assiégée mon vendredi. Le siège a été levé en 2020 et j'écris désormais tous les jours si je veux. Mais c'est grâce à tous ces vendredis que j'en suis arrivé là.
À propos de mon rapport au vrai et à l'imaginaire dans l'écriture,
je ne résiste pas au plaisir de vous livrer cet extrait du monde selon Garp de John Irving :
“Il attendait le moment où elle lui demanderait : et alors ? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est inventé ? Il lui dirait alors que rien de tout ça n'avait la moindre importance ; Elle n'avait qu'à lui dire tout ce qu'elle ne croyait pas. Il modifierait alors cette partie. Tout ce qu'elle croyait était vrai ; tout ce qu'elle ne croyait pas devait être remanié. Si elle croyait toute l'histoire, dans ce cas, toute l'histoire était vraie.”
